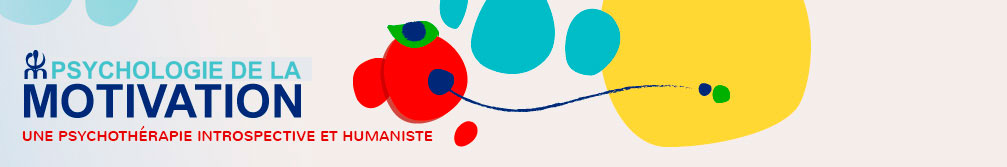A la différence de Freud, d’Adler et de Jung, dans la lignée desquels le plaçait Henri Wallon, Paul Diel, psychologue français d’origine autrichienne (1893-1972), n’a pas, en premier lieu, élaboré sa conception du fonctionnement psychique à partir de la souffrance d’autrui. Il n’était pas médecin : il fut, on le verra, son premier patient... Philosophe de formation et passionné de science, il était aussi poète et avait eu l’ambition de devenir romancier. Sa correspondance avec Musil ou Schnitzler témoigne de son intérêt pour la littérature.
C’est au cours de l’élaboration d’un roman dans lequel il voulait concentrer l’essentiel de son expérience et de ses interrogations qu’il découvrit l’œuvre d’Adler puis celle de Freud. Il y trouva un éclairage salutaire sur les motivations qui le tourmentaient et, sans sous-estimer ce qu’il avait pu apprendre des philosophes et plus encore des grands découvreurs d’âme de la littérature — les tragiques grecs, Shakespeare, Cervantès, Dostoïevski, Zola — il prit la décision de faire œuvre de psychologue.
Prenant en compte la notion d’inconscient et de refoulement chez Freud et celle des sentiments d’infériorité et de supériorité - condensés dans la notion de « politique de prestige » - chez Adler, il s’investit dans un travail d’auto-analyse méthodique, découvrant la causalité secrète de sa souffrance (il dira plus tard la légalité, les lois du psychisme). C’est la tendance à l’évasion imaginative et à la fausse justification de soi-même - « péché originel de la nature humaine » - qu’il repérait ainsi en lui-même. Il décrira plus tard les méfaits individuels et collectifs que cette tendance entraîne, et le bienfait d’apprendre à s’en libérer.
Sa décision essentielle tint dans ces quatre mots : ne plus me mentir. Il avouait même s’être dit « me comprendre ou me pendre ». La lecture d’Adler lui fit mettre le doigt sur ce qui déterminait de façon contradictoire, ambivalente, beaucoup de ses sentiments et de ses comportements : la quête obsédante de l’estime d’autrui, accompagnée du doute sur lui-même et de la fuite dans des imaginations compensatrices et dans des justifications faussement apaisantes. « Quel est ce névrosé dont parle Freud ? » s’était-il demandé. Question analogue à celle posée par le Sphinx à Œdipe. Mieux qu’Œdipe, peut-on dire, il sut répondre : « Cet homme, c’est moi ». « Je serais devenu paranoïaque sans ce regard nouveau, volontaire et méthodique sur moi-même », disait-il. Il comprit que l’homme reste le jouet de ses motivations tant qu’il n’en saisit pas les racines et le sens. Élucidant son propre parcours, il comprit la nature de la souffrance que peut vivre l’enfant : l’insuffisante réponse à ses vrais besoins de sécurité, d’amour et d’estime, ses frustrations, la révolte-soumission née de son désarroi. Mais il comprit aussi comment l’enfant accroît lui-même ce désarroi par sa fuite dans les rêveries et les fausses justifications.
Il appellera fausse motivation cette tendance à s’évader de soi-même et à se duper subconsciemment. Il n’avait eu, en effet, qu’à revenir à sa propre histoire : celle d’un enfant né à Vienne d’un père inconnu, d’une mère aimante mais contrainte de le placer très tôt dans un orphelinat religieux aux mœurs ascétiques et répressives. Il retrouva avec bonheur à 13 ans une vie commune avec sa mère, mais celle-ci mourut un an après. Il fut sauvé de l’abandon complet par un tuteur attentif, père de 5 enfants ; ceux-ci ne réagirent pas sans jalousie à l’arrivée de cet intrus… Aussi choisit-il, après avoir réussi son baccalauréat, de vivre en toute indépendance, au prix, il est vrai, d’une très grande pauvreté. Une grave blessure au bras survenue au cours d’un duel d’étudiants, encore à l’honneur dans la Vienne de 1910, lui valut de longs séjours à l’hôpital ; il les évoquait comme de longues haltes, bénies, qui lui permettaient de s’adonner avec insouciance à l’étude de la philosophie et des sciences. Cette infirmité lui valut aussi d’échapper à la première guerre mondiale.
Grâce à sa femme, française, il put, en 1938, quiiter l’Autriche devenue nazie. Venu en France, il dut passer les années de guerre au camp de Gurs où le régime de Vichy regroupait les étrangers considérés comme indésirables. Il réussit malgré tout à remplir des cahiers entiers de ses recherches sur le symbolisme des mythes. Avec l’appui d’Einstein, qui dès 1935 avait reconnu l’importance de son apport (« Votre œuvre est un remède à l’instabilité éthique de notre temps » lui écrivait-il), il entra en 1945 au CNRS dans le Laboratoire de Psychobiologie de l’enfant que dirigeait Henri Wallon.
À 54 ans, en 1947, après beaucoup d’essais infructueux de publication de ses premières œuvres écrites en allemand, il publia "Psychologie de la motivation" aux Presses Universitaires de France. Il avait eu la possibilité d’exercer et de développer les applications psychothérapiques de sa méthode introspective à l’hôpital central de Vienne, dans le service d’orthophonie, puis à Paris à l’hôpital Sainte-Anne dans le service du Pr. Claude, et par la suite chez H. Wallon. Celui-ci témoigna avec force de ses succès thérapeutiques auprès des enfants et des adolescents pré-délinquants de l’après-guerre.
De ce parcours singulier, Paul Diel sut tirer des propositions universelles, offertes à l'expérience de chacun, sur ce qui peut conduire l’être humain vers l’angoisse ou vers la joie (*).
Armen TARPINIAN
(*) La vie de Diel a été un modèle de « résilience », nous dirait aujourd’hui Boris Cyrulnik… On pourrait même ajouter, par hypothèse, que sa théorie psychologique, fondée sur le socle de la « recherche de satisfaction », permet de comprendre comment s’opère cette résilience face aux pires malheurs : comment en développant sa force d’acceptation et d’action le sujet « tricote », selon le mot de Cyrulnik, sa réémergence vers l’apaisement ou la joie de vivre.