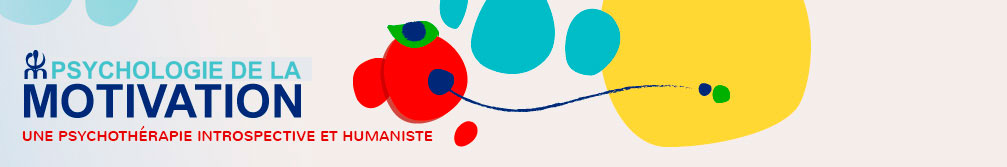ENTRETIEN AVEC EDOUARD ZARIFIAN
Tranquillité et tranquillisants
Nous déplorons profondément la récente disparition d'Edouard Zarifian, survenue le 20 février 2007, dans sa 65ème année. Sa collaboration et son attachement à la revue furent un inappréciable soutien. Il nous avait aidé, alors qu'il luttait déjà contre la maladie, à préparer le N° 39, Regards sur la santé (juillet 2005).
Cet entretien où il s'exprime avec vivacité et sans détour demeure, dix ans après, d'une totale actualité."
Ses derniers ouvrages sont La force de guérir (1999) et Le goût de vivre, (2005), Editions Odile Jacob.
Revue de psychologie de la Motivation. 1997 ¾ N° 24
TRANQUILLITÉ ET TRANQUILLISANTS
POUR UNE APPROCHE PERSONNELLE
ET SYSTÉMIQUE DE LA SANTÉ
" Mais j'ai cru trouver au moins bien des compagnons en l'étude de l'homme. J'ai été trompé : il y a encore moins qui l'étudient que la géométrie. Ce n'est que manque de savoir étudier cela qu'on cherche le reste "
Pascal
Armen TARPINIAN : Le mot « autrement » est à la mode. L'élection législative récente n'était-elle pas placée par les uns et les autres sous l'invocation du "gouverner autrement"? Le mot renvoie au sentiment que chacun éprouve plus ou moins clairement qu'il faut repenser, dans le fond et non seulement dans la forme, nos valeurs et nos modes de vie, si on ne veut pas aller, comme on dit, dans le mur. L'insécurité vient, paradoxalement, de ce que les progrès de tous ordres, tout en nous apportant du mieux-être, nous font craindre — et vivre — le pire... Les progrès de la technologie si prometteurs de "temps libéré" conduisent au chômage. Ceux de la médecine à des maladies nouvelles ou à des dérives. Votre dernier livre, Le Prix du bien-être, en traite un des aspects particulièrement important : l'usage abusif des médicaments psychotropes (tranquillisants, antidépresseurs, hypnotiques, neuroleptiques) auquel nous pousse un système très complexe de causes individuelles, collectives, idéologiques, commerciales. Votre livre, ou plus exactement le rapport officiel que vous aviez présenté et dont il est inspiré, a fait, comme on dit, du bruit dans Landernau, ou jeté un très gros pavé dans la mare…
Mais avant de nous raconter cet épisode, de nous dire comment en venir à des usages plus raisonnables de ces médicaments, et comment, surtout, sortir d’une approche trop réductionniste de la maladie et de la santé, pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel? Vous avez été, si je ne me trompe, un promoteur, sinon, le promoteur en France de la "psychiatrie biologique". Ne s'agissait-il pas d'une tendance à vouloir expliquer la maladie mentale par des causes essentiellement neuro-biologiques ? Comment en êtes-vous arrivé, comme le montrent vos derniers ouvrages, à la conception "systémique" de l'art médical?
Un parcours
Édouard ZARIFIAN : Je ne me suis pas dirigé vers la médecine par goût. Cela a été un concours de circonstances et, au fond, la manière de réaliser le désir de mes parents. Mes goûts étaient littéraires, j'étais passionné par l'espagnol. J'ai failli partir comme lecteur de français à l'université de Mexico, et c'est en raison de circonstances personnelles et familiales que je me suis inscrit au PCB à l'époque. C'est la mort dans l'âme que j'ai dû réduire mes lectures pour préparer les concours. Je rêvais aussi d'être journaliste. J'ai d'ailleurs tenu pendant cinq ans la rubrique médicale du Figaro, puis j'ai été rédacteur en chef du premier journal médical vidéo qui s'appelait Médiscope. Ma carrière médicale a donc été sinueuse et entrecoupée de périodes très différentes, sans que j'interrompe jamais ma pratique psychiatrique. J'ai eu une formation classique, j'ai été interne des hôpitaux de Paris, puis chef de clinique. Lorsque j'étais externe, j'ai eu pendant deux ans une formation analytique, bien que je ne pensais pas alors devenir psychiatre; mais je ne me suis pas engagé dans un cursus psychanalytique.
J'ai fait mon internat en neurologie et c'est là que j'ai découvert la neurobiologie. J'avais été très influencé par Jean Delay chez qui j'avais été externe et qui m'avait montré que la psychiatrie permettait d'être médecin sans abandonner pour autant le plaisir de la lecture et les recherches littéraires. Cela m’a déterminé à me diriger vers une médecine qui ne soit pas strictement somatique. J'ai en effet introduit en France, avant les années 1980 — cela était tout nouveau à l'époque — les techniques de psychiatre biologique que j'avais découvertes aux États-Unis. Ces techniques, que je ne peux détailler ici, concouraient à la recherche d'un index biologique authentifiant l'organicité d'un trouble psychique. J'ai créé en 1978 l'Association française de psychiatrie biologique dont j'ai été secrétaire général pendant sept ans et que j'ai quittée parce que j'étais en contradiction avec les dérives que je constatais. En effet, cet axe de recherche tendait à s’imposer comme la représentation unique du sujet souffrant et, dans ses conséquences pharmacologiques, la modalité unique de traitement. La psychanalyse ayant probablement déçu un certain nombre de gens parce qu'elle a connu ses excès également, la psychiatrie biologique ouvrait des perspectives à condition toutefois de lui poser les bonnes questions, ce qui n'était pas le cas. La question "délirante" était : trouvez moi le gène de la schizophrénie.
A.T. : Quelles sont les bonnes questions ?
E.Z. : Ce serait par exemple : montrez moi le déterminisme biologique favorisant la vulnérabilité de tel ou tel sujet à développer des symptômes en fonction des événements personnels ou sociaux qu'il est amené à vivre.
Voyant les excès auxquels cela conduisait, les dérives, la récupération immédiate et formidable par les industries du médicament, j'ai pris une distance très critique où je n'épargnais pas mes propres publications précédentes... Cela n'a pas été sans contrecoup. On m'a dit : "Tu craches dans la soupe". Les gens ne vous autorisent pas facilement à moduler votre pensée, à changer d'attitude, à être critique à l'égard de vous-même. Surtout quand ils vous ont suivi, ils ont le sentiment d'être trahis. En réalité, mon expérience pratique, indépendamment de mes lectures et de ma formation analytique, me convainquait que je ne pouvais soigner en ne m'occupant que des symptômes. J'étais soucieux de la psychologie singulière de chaque individu, et grâce à la découverte de l'approche systémique, c'est-à-dire de l'analyse des systèmes de communication entre les êtres, je me suis beaucoup intéressé à la dimension sociologique.
L'étape où je me trouve actuellement me conduit à accorder une place importante à la spiritualité : aux approches religieuses ou philosophiques de chacun. Ne faut-il pas défendre l'idée que l'homme est à la fois un corps biologique sur lequel on peut avoir une action matérielle et pharmacologique, un psychisme qui est unique (je dis à mes amis neurobiologistes "tous les cerveaux morts se ressemblent à peu près, aucun cerveau vivant n'est identique à un autre"), mais qu'il a aussi une troisième dimension que j'ai envie d'appeler l'âme, qui est ce besoin de spiritualité qui parait spécifique à l'homme et qu'on ne peut jamais complètement gommer quelles que soient les situations de crise, les dictatures, les génocides etc. Au fond il faut être fier de cela plutôt que d'avoir une attitude bêtement matérialiste en disant : "Vous refusez la modernité", comme je me l'entends dire par certains neurobiologistes. Je suis actuellement plongé dans ces questions. J'ai mesuré aussi mon inculture dans bien des domaines et j'essaie, à 55 ans, de rattraper le temps perdu. Je suis plongé dans l'histoire des religions et j'y découvre plein de clés pour comprendre le présent. Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël et dans les pays qui l'entourent, comment comprendre ce qui se passe à Jérusalem si l'on ne connaît pas l'histoire de Jérusalem? Et c'était des pans entiers d'information qui me manquaient complètement. Ainsi, grâce à votre revue, j'ai découvert Diel. Ce n'était qu'un nom pour moi. J'ai commencé à aborder son oeuvre. Sa vision de l'évolution et du symbolisme des mythes est tellement riche qu'il ne faut pas que je lise cela en diagonale... Ainsi, ses pages sur le mythe d’Asclépios m'apportent un réconfort extraordinaire et l'envie d'approfondir ma réflexion. Sa conception de l'interaction entre l’harmonisation intérieure et l'hormonisation éclaire vivement le lien entre la sagesse intuitive de la médecine antique et les recherches psychosomatiques d'aujourd'hui.
Les psychotropes
A.T. Nous pourrions en venir, si vous le voulez bien, à votre dernier livre, aux enjeux qu'il soulève, aux tabous qu'il ose attaquer, aux enseignements, et à la réflexion fondamentale où il conduit. Le thème de l'ensemble de ce numéro étant "le quotidien autrement", ce que nous voudrions pouvoir peut-être montrer avec vous, c'est ce que nous coûte individuellement, socialement, économiquement, notre incompréhension de ce que nous vivons réellement au niveau de notre santé physique et mentale.
E.Z. Pour répondre à votre question, je partirai du fait que la médecine aujourd'hui me semble fascinée par la science. Certes, elle doit emprunter à la science pour être plus performante dans son exercice quotidien, mais sa démarche est différente. La science a pour but d'expliquer, la médecine de soigner. Or on voit le rapport inter-humain s'effacer au bénéfice de la réparation d'organes. On en arrive à parler du clonage humain comme possibilité de constituer des banques d'organes.
Cette situation de la médecine me rappelle le livre de Jules Romains Hommes, médecins, machines où il se gaussait d'un test extraordinaire, le test de l'ongle, qui consistait à envoyer un certain rayon sur l'ongle du pouce; l'angle de réfraction permettait de déduire les maladies des patients, et très vite apparaissaient les spécialistes de l'ongle droit et les spécialistes de l'ongle gauche. J'ai vu aux États-Unis se mettre en place cette médecine; je pense à un haut lieu de la technologie médicale, la Mayo Clinic à Rochester dans le Minnesota: on entre dans un tunnel où de part et d'autre se trouvent des cabinets de médecins spécialisés; on vous demande de faire vos besoins dans un pot, vous passez cela par une petite lucarne, on vous met des tubes partout etc. Au bout du parcours, vous recevez le diagnostic sans avoir réellement « parlé » à un seul médecin.
C'est en réaction vitale à cette approche mécanique de l'être humain souffrant que j'ai écrit mes premiers livres pour le grand public. C'est sur la base du dernier d'entre eux, Des Paradis plein la tête, où je montrais le danger et la dérive de l'utilisation des médicaments psychotropes, que Simone Veil m'a demandé de faire une véritable enquête portant sur l'usage des psychotropes en France, en le comparant à l'usage qui en est fait dans les autres pays d'Europe et en essayant de comprendre le pourquoi des différences. Les pouvoirs publics ont souhaité que ce soit l'affaire d'un homme seul et pas d'un groupe de travail pour éviter le risque d'aboutir à un consensus mou. Je me suis entouré toutefois d'un comité de pilotage représentatif de toutes les instances; je n'ai voulu laisser de côté aucune source d'informations. La demande était : aller jusqu'au bout des choses, ne rien laisser dans l'ombre. Mais je ne me suis pas rendu compte que c'était à mes risques et périls. J'ai fait deux choses qui m'ont valu les réactions que je vais vous décrire. D'une part, j'ai décrit le système de santé ; or la description d'un système est insupportable pour le système. J'ai rapporté par exemple des comportements d'individus qui ne sont reconnaissables que par ceux qui sont concernés. Cela m'a valu et me vaut une hostilité incroyable. D'autre part, j'ai montré les risques de trafics d'influences sévissant à l'Agence du médicament ainsi que la confusion des genres : faire partie des commissions de recherche et d'expertise et, dans le même temps, émarger à des laboratoires pharmaceutiques dont on juge les produits...
J'ai donc à la fois décrit un système et j’ai contesté l'impartialité de certains experts. Je l'ai fait à un moment où d'autres affaires allaient mettre en cause cette impartialité : la vache folle ou l'affaire de l'amiante etc. J'ai montré aussi que le médecin français, sauf à acheter des journaux de langue anglaise, dispose de très peu d'informations indépendantes des annonceurs. Or, la manipulation de l'information concernant l'utilisation du médicament génère chez le médecin des représentations des pathologies telles qu'elles induisent une seule attitude : la prescription de médicaments. Qu'il s'agisse de suicide, de dépression, d'anxiété, de difficultés conjugales, scolaires etc.
Ce rapport était initialement un rapport confidentiel. Et puis, un jour, il y a eu une fuite et L'Express a fait sa couverture avec un grand titre "Le rapport qui accuse l'industrie pharmaceutique". Cela a soulevé des remous énormes; j'ai été attaqué par mes pairs et par l'industrie pharmaceutique, bien sûr. On a essayé différentes mesures de rétorsion.
A la suite de ce rapport, mon éditeur , Odile Jacob, m'a poussé à m'expliquer de façon à ce que le grand public puisse me juger en fonction de ce que j'ai réellement dit. C'est ce que j'ai fait avec Le Prix du bien-être : j’y livrai le constat qu'en France, on consomme deux à quatre fois plus de médicaments psychotropes que dans n'importe quel autre pays d'Europe. Les chiffres sont préoccupants : 12% de la population française consomme tous les jours au moins un psychotrope depuis plus d’un an. Les psychotropes les plus consommés sont les tranquillisants (7%), puis les hypnotiques (3%), les antidépresseurs (2%) et le marché des antidépresseurs augmente tous les ans de 6% depuis 6 ans.
A.T. J'ai été frappé par la différence énorme entre la consommation des psychotropes en Angleterre et leur consommation en France.
E.Z. Les différences ne concernent pas seulement les médicaments psychotropes. Nous consommons en France deux fois plus d'antibiotiques que dans n'importe quel pays d'Europe, nous consommons quinze fois plus d'anti-migraineux, quatre fois plus de vasodilatateurs. Que se passe-t-il dans ces autres pays où existent également la promotion et la publicité pour les médicaments? Dans le cas de l'Angleterre, les médecins appartiennent à un service public. Aussi, qu'ils prescrivent peu ou beaucoup, ils n'en tirent pas d'avantages personnels. De plus, il existe une formation et une information continues indépendantes de la promotion. Si vous lisez, par exemple, The Lancet, vous n'y verrez pas de publicité. En France, la revue Prescrire est la seule qui ne contienne pas de publicité pharmaceutique. Créée conjointement avec les pouvoirs publics qui l’ont, au départ, financièrement aidée, elle est maintenant indépendante. Elle est lue par de plus en plus de médecins généralistes.
Le grand enjeu de la médecine de demain, c'est d'avoir une formation médicale continue indépendante de toute pression. La formation médicale continue est légalement obligatoire en France depuis un an. Jusqu'à l'année dernière, un médecin qui sortait de la faculté de médecine pouvait ne plus ouvrir un livre jusqu'à sa retraite. Une loi a été votée au Parlement. Certaines manifestations ou certains outils de formation (livres, revues, etc.) se verront attribuer des points d'accréditation et le médecin, en fin d'année, devra justifier d'un nombre de points minimum. Un conseil national de la formation médicale continue édicte actuellement des critères qui doivent garantir l'indépendance du contenu de la formation. Si nous ne parvenons pas à garantir cette indépendance, nous aurons une médecine de plus en plus insatisfaisante. Les pouvoirs publics ont adopté jusqu'à présent une attitude attentiste et observent de voir ce que va faire la profession. Car, il ne faut pas oublier que la santé est un gigantesque marché économique...
Certes, on ne crée pas l'anxiété existentielle mais on crée une entité fictive qui est le concept d'anxiété pathologique-maladie; et en utilisant tous les vecteurs habituels, la presse grand public, la presse féminine etc., on fait en sorte qu'il y ait une demande exprimée par l'usager de la santé, qui est devenu un consommateur de remèdes... Il suffit de penser aux antidépresseurs qui défraient la chronique. Il ne faut pas cependant se focaliser sur le médicament. Le marché économique de la santé, c'est toutes les infrastructures de santé (cliniques, appareillages, kits d'analyse biologique etc.). Il y a là des abus dont on n'est guère informé, sinon par des entrefilets dans les journaux : c'est l'exemple de ces nombreux chirurgiens poursuivis par la justice parce qu'ils avaient mis des genoux artificiels à des gens qui n'en avaient pas tous nécessairement besoin...
Plusieurs de mes amis m'ont reproché de leur compliquer la tâche parce que mes livres incitent les malades à poser des questions aux psychiatres. L'un d'entre eux m'a dit après la parution de Paradis plein la tête : "Tu casses la baraque !". Il voulait dire par là que les psychiatres ne pourraient plus dire ce qu'ils veulent aux malades. Or, j'ai peur d'avoir à leur compliquer encore plus la tâche car je veux dans mon prochain livre inciter les malades à se prendre en charge, à devenir co-responsables de leur santé et à poser des questions. A ne pas être passifs mais actifs dans la prise en charge de leur santé.
Le malheureux et le malade
A.T. Cependant, on ne peut oublier qu'il n'y a pas de conditionnement sans conditionnabilité. Il y a au départ une demande qui est : « Comment puis-je être aidé à ne plus me sentir malheureux, à ne plus me sentir un malade ? »
E.Z. Vous avez prononcé le mot : malheureux. Mon livre s'intitule Le Prix du bien-être. Il y a un glissement, une dérive : le malheureux devient le malade. Pour un directeur de marketing, c'est une situation de rêve, à savoir, que l'on prend une caractéristique inhérente à la condition humaine et l'on en fait un marché.
A.T. On ne peut s'empêcher de penser, d'autant qu'il s'agit d'une question d'actualité, au coût supporté par la Sécurité sociale.
E.Z. Vous avez tout à fait raison. La différence avec d'autres exemples, c'est qu'ici, c'est la communauté qui paie.
A.T. Dans votre livre vous dites qu'en Belgique, les benzodiazépines ont cessé d'être remboursés mais qu'ils continuent d'être autant consommés qu'en France. Comment l'expliquez-vous?
E.Z. Parce qu'il s'agissait d'un produit entraînant une dépendance. Lorsque l'on augmente le prix du tabac, on ne réduit pas significativement le nombre de consommateurs puisque les gens sont déjà accrochés. Mais lorsque le remboursement des vitamines, produit plus neutre, a été supprimé, les gens ont nettement freiné leur consommation.
A.T. Je voudrais vous poser une question directe. Ce que vous dénoncez avec beaucoup d'objectivité ne peut-il pas produire, à côté des effets positifs d'interrogation des malades par rapport à l'usage qui est fait des psychotropes, des effets négatifs, une sorte de placebo nocif, un nocebo, face à un usage thérapeutiquement nécessaire?
E.Z. C'est là une véritable préoccupation. Le vrai risque de mes prises de position, c'est qu'elles jettent une défiance sur des médicaments que je juge indispensables pour certaines personnes. Mon combat concerne l'utilisation abusive de médicaments psychotropes par des personnes qui n'ont pas de troubles psychiques se situant dans le cadre de la pathologie. Cela complique presque inévitablement la tâche du médecin; mais ne doit-il pas en faire une occasion d'enrichir la relation, l'échange patient-médecin? Sans minimiser la difficulté, je suis convaincu que le silence sur l'usage abusif des psychotropes est infiniment plus maléfique.
Politique de la maladie et politique de la santé
A.T. J'aimerais maintenant que l'on dépasse l'aspect strictement économique. La médecine aurait tendance à nous considérer seulement comme organes, la spiritualité seulement comme âme, la société comme être social. Donc comment sortir de ces conceptions réductrices? Je rappellerai cette réflexion de Basarab Nicolescu dans le dernier numéro de notre revue : "La connaissance ou l'ignorance de ce que nous sommes, de notre être intérieur, a certainement des répercussions considérables sur la santé individuelle et sur les choix de nos politiques de santé. En fait, nous sommes plutôt prisonniers d'une politique de la maladie et des réponses surtout techniques que nous proposons, au lieu d'essayer de concevoir une véritable politique de la santé. Les patients sont traités en objets atteints de toutes sortes de handicaps organiques, de maladies, mais l'importance de la sécurité ou de l'insécurité intérieure est fort peu prise en compte. Nous avons même créé de nouveaux types de maladies, celles induites par les soins médicaux : les maladies iatrogènes (*) . Cette situation, coûteuse à tous points de vue, appelle de vrais changements de mentalité conduisant à réintégrer les dimensions de l'univers intérieur dans la discipline médicale."
Vous, Professeur Zarifian, votre réflexion, je suis sûr, vous a conduit dans cette direction. Comment aller d'une politique de la maladie à une politique de la santé?
E.Z. Vous savez, dans notre société en général et dans le domaine médical en particulier, nous allons complètement à rebours de ce que proposait Kant, à savoir que l'homme doit être une fin et non un moyen. Par ailleurs, l'hyper-prescription de psychotropes et de médicaments en général, exploite la croyance que tout ce qui peut nous être bénéfique doit venir de l'extérieur, plaçant ainsi les individus dans une situation de passivité-dépendance. Dire aux gens : "Il y a des ressources en vous" apparaît presque comme subversif.
Comment en sortir ou comment s'en sortir? Il faut faire référence nécessairement à l'individu et au groupe. La situation actuelle est alimentée essentiellement par les représentations sociales et par les représentations individuelles. Les représentations sociales sont très difficiles à modifier. Les représentations individuelles sont les seules que l'on puisse espérer modifier rapidement. Pour que les représentations sociales changent, il faut qu'une masse critique d'individus au sein du groupe ait modifié ses représentations individuelles. Les logiques économiques des industries touchant aux médicaments entrent aujourd'hui de manière aiguë en conflit avec l'éthique. L'éthique en santé publique, c'est de ne pas nuire. Prenons l'exemple des antibiotiques. On en consomme en France deux fois plus que dans n'importe quel pays d'Europe. Or, les antibiotiques utilisés par les médecins généralistes sont ceux de dernière génération. Ces antibiotiques, qui sont les plus puissants, vont très vite devenir inefficaces car l'on va fabriquer des germes résistants. Utilisés exclusivement, comme ils auraient dû l'être, dans les pathologies où elles s’imposent, ils n’auraient pu constituer un marché.
Pour revenir à votre question sur la santé, je voudrais faire une comparaison entre le français et l'anglais. En français, il n'y a qu'un seul mot pour désigner la maladie alors qu'il en existe trois en anglais : le mot disease signifie maladie en tant que savoir du médecin sur la maladie; le mot sickness représente le savoir du malade et ses représentations sur sa maladie; le mot illness désigne la représentation sociale de la maladie. Lorsque l'on prend en compte ces trois aspects, comme j'essaie de le faire dans ma pratique, le mot guérison devient un discours à trois voix qui doivent coïncider : vous êtes guéri; je me sens guéri; il est guéri.
A.T. Cette triple approche permet-elle de mieux diagnostiquer les causes de la maladie qui peuvent être biologiques ou/et psychiques?
E.Z. Disease, c'est le biologique, sickness, c'est le psychique et illness, c'est l'interaction entre le sujet et le milieu
A.T. A propos de cette interaction, vous rappelez dans votre livre que la médecine, ce n'est pas seulement administrer des médicaments. La médecine, c'est aussi la relation, le sujet qui consulte n'étant pas seulement un corps souffrant. On peut déplorer qu'une évidence aussi criante ne soit pas méthodiquement prise en compte.
E.Z. C'est la différence entre disease et sickness. C'est savoir aider celui qui souffre à discerner ce qui est une souffrance pathologique, nécessitant l'intervention du médecin, de la souffrance humaine naturelle qui ne requiert pas les mêmes réponses. Je prendrai un exemple. Une dépression vraie est une souffrance psychique qui nécessite un traitement médicamenteux et psychologique; par contre, un deuil est une souffrance considérable que je peux être amené à aider mais pas de la même manière et pas en tenant le même discours.
Tranquillité et tranquillisants
Ce que je ne veux pas, c'est qu'à partir des symptômes qui caractérisent la dépression et dont certains caractérisent aussi la tristesse, on baptise dépressifs des gens tristes.
Certains me disent "Tu laisses souffrir les gens". Non, refuser de donner un tranquillisant, cela veut dire donner beaucoup de temps, on est alors efficace sans être nocif.
A.T. Oui, il doit y avoir d'autres voies pour retrouver la tranquillité que les tranquillisants. Votre remède, c'est le temps qui permet la relation. Il s'agit d'une donnée qui n'est pas prise en compte par la Sécurité sociale, alors qu'à y réfléchir de près, ce serait une bonne voie pour assainir ses comptes...
E.Z. De plus, utilisés à bon escient, les tranquillisants peuvent procurer un certain bienfait, mais utilisés par des gens qui ne souffrent pas d'une anxiété pathologique, inhibante, ils présentent beaucoup d'inconvénients. Et lorsqu'on en consomme depuis des années, comme c'est le cas de beaucoup de Français, cela entraîne une indifférence affective dont personne n'a mesuré les conséquences sur la vie conjugale, sociale, professionnelle, ni sur les accidents du travail et de la route... J'ai parlé à cet égard de génocide de l'esprit.
Autre aspect des choses. Aujourd'hui, on ne meurt plus de méningite tuberculeuse. Les performances de la médecine sont tellement extraordinaires qu'on en attend plus que de raison. La médecine est devenue le foyer de projections magiques intenses. Mais rapporté à la réalité des faits, il faut s'interroger sur ce qui revient à l'impact des médicaments dans les progrès de la santé publique. On sait que les progrès de la médecine n'interviennent que pour 10% environ dans l'amélioration de la santé. D'où vient le reste? Cela vient d'abord de la nutrition. Ensuite de l'hygiène. On ne peut cependant voir les choses par le petit bout de la lorgnette en appuyant nos réflexions uniquement sur la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce que la santé en Afrique Noire, où la méningite cérébro-spinale sévit de manière endémique et où on ne donne jamais, faute d'argent, de médicaments ? La tuberculose est endémique dans les favellas du Brésil. Pourquoi? Il y a bien des remèdes antituberculeux mais il n'y a aucune hygiène et pas de nutrition. La tuberculose resurgit en France parce que l'on connaît un sous-prolétariat. Donc, on ne peut penser antibiotiques sans penser aussi hygiène et nutrition. Cela ne peut en rien diminuer l'intérêt majeur du médicament, mais il ne faut pas dire, pour des raisons économiques, où le profit prévaut sur toute autre valeur : « Il ne leur manque que le médicament qui sauve. » (*)
La formation
A.T. On a, à l'inverse, dans les sociétés très développées, des maladies dues non pas à la sous-nutrition mais à la surnutrition...
Pour en venir au problème central de la formation, vous insistez sur le manque d'informations des médecins — et du public — sur les effets pervers de l'usage abusif des psychotropes et autres médicaments. Vous venez de rappeler que les médecins sont préparés à soigner des organes plus que des personnes. Mais n'y a-t-il pas des percées, des évolutions positives qui s'observent ici ou là? La psychanalyse, la recherche psychothérapique et psychosomatique, ne font-elles pas tomber les préjugés?
E.Z. On a pris en partie conscience de ce problème lorsque justement on a voulu introduire les sciences humaines en début d'études de médecine. Mais cela a été fait de manière précipitée et n'a pas porté ses fruits.
Je dois vous dire que je me suis élevé contre le fait qu'il n'y a que trente heures d'enseignement théorique en psychologie médicale pendant les huit ans de médecine. Et l’on peut déplorer que pendant les quatre ans de formation des futurs psychiatres, il n'y ait, au niveau national, aucun enseignement systématiquement organisé qui initie à la relation médecin-malade et à la prise en charge psychothérapique. En Allemagne, un infirmier psychiatrique doit, lors de son cursus, avoir des entretiens pendant un an avec au moins un patient sous la supervision d’un psychothérapeute-formateur.
La négligence du fait psychique est quand même le résultat de la glorification de la science toute puissante. Ce que la science, ou plutôt l'idéologie scientiste, n'explique pas ou ne peut pas appréhender, elle le nie ou bien le minimise. Certaines cultures prennent en compte des aspects de l'homme négligés chez nous et peuvent même aboutir à des faits absolument indéniables, non expliqués par la science officielle. Le scientisme nie ces faits, comme par exemple l'influence de la volonté sur la fréquence cardiaque.
Je pense cependant que les généralistes sont plus proches d'une conception disons personnaliste de leur métier. Pour ma part, le combat que je mène est aussi pour eux. J'ai vu des médecins généralistes tout à fait remarquables, connaissant les familles, comprenant les choses, intervenant comme il faut.
A.T. Peut-on donner une définition de ce que peut être une véritable activité médicale, proposer une sorte de modèle idéal et voir comment il peut être appliqué, en tenant compte des contraintes inévitables? De même qu'il nous faut redéfinir l'acte pédagogique, il me semble qu'il nous manque une vraie conception de l’acte médical. Comment la définiriez-vous ?
E.Z. Je reprendrai les trois aspects que j'ai évoqués avec les trois mots anglais qui désignent la maladie : disease, sickness, illness. Le premier aspect est la prise en compte du savoir médical et scientifique. Le deuxième aspect concerne la capacité à écouter l'autre en tant que sujet unique. Un de mes professeurs disait : « C'est le malade qui doit vous apporter le diagnostic. » Il faut écouter avant d'examiner. Or, aujourd'hui, on n'écoute guère, on se précipite plutôt sur les examens complémentaires. Le troisième aspect contribue à situer le sujet souffrant dans son environnement relationnel et à identifier les représentations qu’il en a.
La psychologie médicale
A.T. Pourriez-vous préciser la différence entre psychologie médicale et psychologie curative ? Être plus au fait de la psychologie médicale ne veut pas dire forcément que l'on est psychothérapeute ?
E.Z. Pas du tout. Être psychothérapeute nécessite une formation spécifique. En revanche, la psychologie médicale que j'enseigne concerne la vérité à dire ou à ne pas dire aux malades, le secret professionnel, la réflexion sur le normal et le pathologique, le sens des mots soigner, guérir, les représentations individuelles et sociales de la santé et de la maladie, et bien sûr ce qui concerne la relation patient-soignant. Une initiation à la psychothérapie — vous diriez peut-être à la relation d’aide — est une chose, être psychothérapeute en est une autre. En revanche, ce qu'on peut apprendre aux médecins en général et a fortiori aux psychiatres, c'est à comprendre mieux ce qui se passe ici et maintenant, dans le registre du récit de ce que vivent les gens et de ce qui se passe dans la relation thérapeutique. (Il existe, comme on sait, les groupes Balint, mais ils sont malheureusement trop peu développés). La psychothérapie des profondeurs qui met en jeu le rêve, l'inconscient, c'est autre chose.
Le normal et le pathologique
E.Z. Dans le domaine de la souffrance psychique, le curseur peut être déplacé comme on veut, et ce qui m'inquiète, c'est qu'on le fait bouger d'une manière illégitime. Comme je l'ai dit, on transforme les malheureux en malades. Car la différence en matière de souffrance psychique entre le normal et le pathologique est uniquement une convention, un consensus liés à la culture, au lieu et au moment. Ne soyons pas dupes de cela.
En ce qui concerne par exemple le délire, on peut dire que le délire de chacun a un sens. Lorsque dans ma pratique, je vois pour la première fois un malade délirant, je ne me précipite pas sur les neuroleptiques, j'écoute d'abord ce qu'il a à dire. Ce serait sinon le réduire à son symptôme.
A.T. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par sens du délire?
E.Z. Le sens du délire concerne d'une part l'histoire du sujet. Les thèmes du délire diffèrent en fonction de cette histoire (thèmes de grandeur, de salut, de persécution etc.). Pour aider le sujet, il faut avoir entendu ces thèmes afin d'en parler avec lui une fois que le dialogue est à nouveau possible. Ne pas en parler, mépriser le délire, c'est laisser l'individu avec une cicatrice indélébile et une culpabilité considérable.
D'autre part, le délire a un sens qui concerne l'économie adaptative du sujet. C'est la tentative ultime, désespérée et infructueuse d'être soi-même face à des contradictions, à des coercitions, à des contraintes, à des conditionnements. Cela ne veut pas dire que je laisse le malade délirer, que je n'utilise pas de neuroleptiques, mais je les utilise sur des périodes beaucoup plus courtes que ce qui se prescrit généralement.
Santé et auto-responsabilité
J’ai dit que les gens doivent apprendre à devenir responsables de leur santé. Cela signifie qu'il faut les informer : chaque citoyen devenu malade a le droit à une information. Je ne dis pas ici qu'il faut forcément dire la vérité au malade. Le médecin doit discerner ce que le patient souhaite entendre. Mais il faut que les gens établissent un partenariat avec le médecin. La question est : "Qu'est-ce qu'on fait ensemble?" A cet égard, le cas du sida constitue un événement majeur dans l'histoire de la médecine. Les sidéens sont devenus détenteurs de l'information au même niveau que le corps médical; ils vont dans les congrès internationaux et sont devenus des partenaires de discussion avec les pouvoirs publics, le corps médical et l'industrie pharmaceutique (ils font baisser les prix de la trithérapie).
C'est bien sûr un cas particulier mais je souhaiterais que les gens participent activement à leurs soins. Un ami me disait " Tu parles en terme de pouvoir médical; quand je vais chez mon garagiste, je ne discute pas". Je lui ai répondu que, justement, il avait tort.
A.T. Les automobilistes ne seraient pas perdants à connaître un peu plus la mécanique... Il faudrait évidemment que les médecins eux-mêmes soient un peu plus au fait de leur propre fonctionnement psychique, de leurs désirs, intentions, motivations.
E.Z. Il est très intéressant d'interroger les médecins qui ont été malades. Certains médecins ont "redécouvert" la médecine après avoir traversé eux-mêmes une grave maladie. Mon maître, Jean Delay, membre de l'Académie française et de l'Académie de médecine, qui avait été hospitalisé à l'hôpital Broussais pour un infarctus du myocarde, me racontait qu'il s'était senti infantilisé par la manière dont il était traité.
A.T. Vous disiez que 90% des progrès de la santé tenaient à des modifications des modes de vie (nutrition, hygiène etc.). Quelle part faites-vous aux autres aspects, culturels, affectifs, psychologiques?
E.Z. J'ai lu chez Diel des choses auxquelles je ne peux que souscrire. Il fait remarquer que même dans le cadre d'infections à germes figurés, tout le monde ne contracte pas cette infection. L'état psychique influe sur l'hormonisation (*).
J'ai personnellement un modèle qui guide ma réflexion : le modèle du "seuil". Je pars d'une idée très simple. Notre cerveau peut, dans des circonstances extraordinaires, connaître n'importe quel trouble psychique. Nous arrivons au monde avec un déterminisme génétique et biochimique qui nous donne un seuil d'apparition des symptômes en fonction de l'interaction que nous avons avec notre milieu et de ce que nous rencontrons dans notre existence. Certains ont un seuil normal; face à des événements "normaux", ils ne présenteront jamais de troubles. D'autres ont un seuil bas (c'est le domaine de la psychiatrie biologique de déterminer ce qui caractérise ce seuil); face à des événements "normaux", ils présenteront quand même des symptômes. Mais ceux qui ont un seuil dit normal présenteront des symptômes s'ils sont confrontés à des événements particuliers : dans des circonstances extraordinaires, tout le monde est sujet à des troubles psychiques.
Cette notion de seuil permet de montrer qu'il n'y a pas de gens normaux ou anormaux mais qu'un ensemble de circonstances peut favoriser l'apparition de troubles. En réponse, on voit toutes les thérapies qui sont possibles : la thérapie biologique qui agit sur le seuil, les thérapies psychologiques qui agissent sur les représentations mentales et sociales, les thérapies comportementales qui nous permettent de modifier notre relation à l'environnement. Aujourd'hui, on est dans le mythe de la biologie moléculaire toute puissante qui ferait dépendre d'une pilule l'évolution complexe et fragile d'une vie.
Il y a cependant une demande des patients qui de plus en plus essaient de trouver des gens capables de les écouter, de les entendre, de les comprendre. J’en ai un vif écho dans les auditoires très hétérogènes auxquels j’ai été confronté (13 villes pour mon dernier livre). Il y a là une majorité silencieuse qu’il faut aider à se faire entendre. L’espoir est plutôt là...
Le rappel du refoulé : l'effet placebo
A.T. Je souhaiterais pour finir vous interroger sur un problème que vous connaissez bien — l'effet placebo — que vous continuez d'étudier, je crois, sous son aspect biologique. Cela est évidemment très important. Pour nous, du point de vue du fonctionnement psychique, cela nous parait être un phénomène central.
On peut s'étonner que l'évidence de l'effet placebo ne contribue pas à mieux ébranler les certitudes organicistes et mécanistes qui constituent le fond de la formation médicale, pas plus d’ailleurs que l’effet-Pygmalion n’ébranle les certitudes des enseignants [1].
Il ne s'agit pas bien sûr de sous-estimer les progrès immenses de la médecine. Mais ses succès laissent dans l'ombre ou font considérer comme très secondaires les déterminations inconscientes qui contribuent à la santé ou la compromettent. Cela est d'autant plus paradoxal que ce phénomène d'ordre psycho-biologique est pris en compte méthodiquement dans la recherche de validation des médicaments. Peut-être consacrerons-nous un numéro de la revue à l'effet placebo tant le phénomène nous apparaît riche de sens comme d'implications pratiques [2] .
E.Z. L'effet placebo est un phénomène relationnel mais qui comporte un substrat biologique. Il est vrai que cela me passionne et continue de faire l'objet de mes recherches. Je peux vous citer l'exemple très parlant d'une expérience faite avec des personnes souffrant de douleurs bucco-dentaires. Il faut se rappeler que n'importe quelle prescription contenant un pseudo-médicament — le placebo — provoque, en moyenne, 30% d'amélioration constatable, par le double mécanisme de suggestion mentale et de sécrétions d'endorphines naturelles qui l'accompagnent.
On a donc administré à un premier groupe deux gélules, l'une pur placebo, l’autre contenant de la naloxone. La naloxone est le bloqueur de l'effet de notre morphine naturelle (qu'on appelle les endorphines). A un deuxième groupe, on a administré deux gélules qui étaient toutes deux du placebo. Dans ce deuxième cas — placebo plus placebo —, il y a eu 30% d'effet positif. 30% des gens ne ressentaient plus de douleurs. Dans le cas placebo plus naloxone, seuls 5% des gens, et cela est hautement significatif, ont reconnu ne plus souffrir. Cela a permis de démontrer que dans une relation médicale, où, pour reprendre le mot de Lacan, un "sujet supposé savoir" et supposé soigner s'adresse à un sujet qui est demandeur, on induit par cette "alchimie" psychologique un effet biologique, la sécrétion d'endorphines. La sécrétion d'endorphines ainsi produite va dans le sens d'une atténuation de la douleur, même si à l’expérience elle a une efficience moins puissante qu'un médicament antalgique.
A.T. Médicament qui bénéficie de toute façon de l'effet placebo.
E.Z. Bien sûr. Il faut toujours soustraire de l'effet pharmacologique l'effet placebo qui est, comme je l'ai dit, de l'ordre de 30% quelles que soient les pathologies, et quelquefois beaucoup plus. Dans l'anxiété, par exemple, cela atteint 60%. Auquel cas, on peut s'interroger sur l'opportunité d'utiliser un produit plus ou moins nocif. En administrant la naloxone, on a bloqué la sécrétion d'endorphines. Le substrat biologique de l'effet placebo a donc été contrecarré, ce qui explique qu'il n'y a eu que 5% d'effet positif. On a donc ainsi démontré que l'effet placebo dans la douleur était dû à l'induction par la relation de la sécrétion d'endorphines naturelles. L'effet placebo dans l'ulcère de l'estomac, c'est 30%. Si la biologie s'intéressait aux mécanismes biologiques mis en œuvre par l'effet placebo dans l'ulcère de l'estomac, on se trouverait au plus près de la co-pathogénie physiologique de l'ulcère gastrique. On découvrirait la substance qui provoque l'ulcère gastrique. C'est un champ de recherche extraordinaire ; il est donc fort attristant que la médecine tire si peu de leçon de l'effet placebo, tout en le reconnaissant puisqu'il ne se fait plus d'essais thérapeutiques sans un groupe contrôlé sous placebo.
A.T. La richesse d’enseignement de l'effet placebo n’appellerait-elle pas une approche inter et trans-disciplinaire de la santé et de la maladie prenant en compte, comme vous le disiez, le corps, l'âme et l'esprit, le biologique et le social, le mental et le culturel ? Mais aussi, la solution de la crise sociale générée par les fameux déficits de la Sécurité sociale, ne dépendrait-elle pas, pour une large part, d’une formation repensée des études médicales incluant ces dimensions, ainsi que d’une éducation à la santé assurée dès l’école primaire ?
E.Z. Vous parlez d’or, dans tous les sens du terme...
Il nous faudrait d’urgence, en effet, à l’école et à la faculté, apprendre à sortir de nos tendances réductionnistes, à redécouvrir la complexité du vivant, à nous placer dans une perspective à la fois personnelle et systémique de la santé et de la maladie, afin de mieux comprendre pour mieux agir non seulement curativement mais tout autant et avant tout préventivement.
Citations : Paul Diel, Mythe d’Asclépios, Extraits (1954) (*)
« Même la cause, peut-être la plus importante des maladies organiques, l’infection, n’est pas due nécessairement et exclusivement à la contamination accidentelle. L’organisme est porteur de germes, et l’affaiblissement de la résistance dû au désordre psychique sera souvent une cause suffisante d’envahissement ».
« La santé du corps dépend de l’harmonie de l’hormonisation. Cette affirmation, commune à Hippocrate et à la médecine moderne, n’est en somme qu’une inversion de la sagesse mythique, qui, exprimée en termes non symboliques, peut se formuler ainsi : l’harmonie des corelations neuro-hormonales dépend de la vie psychique et de son harmonie, donc de la force de spiritualisation-sublimation (dont le symbole est Apollon). »
« L’idéal serait de connaître aussi bien l’enchaînement des causes physiologiques que celui des motifs psychiques. Le désarroi de la psychiatrie moderne pourrait bien venir de l’incapacité où elle est d’établir le parallélisme de ces deux voies explicatives, ainsi que de la tendance à remplir les lacunes de l’explication physiologique par des explications psychiques, et les lacunes de l’explication psychique par des explications d’ordre physiologique. »
« Jusqu’à nos jours, l’esprit qui anime la science psychiatrique se montre plus restrictif que ne l’était la sagesse mythique. Non pas que la psychiatrie nie l’unité « corps-psyché » ; elle la souligne au contraire autant que faire se peut, mais uniquement dans l’espoir de comprendre les troubles de l’âme par l’étude exclusive du dérèglement somatique. La psychanalyse moderne, ouvrant la voie qui mène vers la compréhension du symbolisme mythique, peut être considérée comme une réaction contre cette limitation excessive du problème psychopathologique.
(*) Professeur de psychiatrie et de psychologie médicale, Université de Caen. Auteur de : Les Jardiniers de la Folie (1988), Des paradis plein la tête (1994), Le Prix du bien-être, (Psychotropes et société), Editions Odile Jacob.
(*) Dix pour cent des hospitalisations en France sont dues à des accidents thérapeutiques. Douze mille personnes par an meurent d’infections nosocomiales, c’est-à-dire dues à des germes contractés en milieu hospitalier.
(*) Lu, après cet entretien, dans Le Monde du 12 juin 1997 :
« L’émiettement social et culturel peut-il engendrer des hommes bien portants ? La réponse s’inscrit de plus en plus souvent dans un registre d’exigence ambiante de rentabilité. Les pressions économiques s’exercent à l’encontre du médecin et de son patient. Le premier écoute le second parler de sa santé, mais le manque de temps gêne l’écoute, et la réponse reste trop souvent confiée à un excès de médicaments, après trop de détours vers des examens complémentaires parfois complexes, coûteux et inutiles ». Dr. Gérard Azoulay, pédiatre.
Citons encore, dans le même numéro du Monde, le début du commentaire de J.Y. Nau, d’un article du journal The Lancet critiquant la mise sur le marché du Taxol (médicament contre le cancer des ovaires) : « L’usage plus que l’éthique, veut que les revues médicales ne soient jamais très critiques vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique en raison d’objectifs a priori associés au fait que ces revues trouvent généralement dans cette industrie la quasi-totalité de leurs indispensables ressources publicitaires... ». [NDLR].
(*) Voir extraits de Diel en fin d’article.
[1] L’effet-Pygmalion et l’effet-Persée. Revue N° 18, 1994.
[2] Voir le livre de Patrick Lemoine, Le mystère du placebo, Odile Jacob, 1996.
(*) Le symbolisme dans la mythologie grecque, P.B. Payot, 1995.
Cet entretien où il s'exprime avec vivacité et sans détour demeure, dix ans après, d'une totale actualité."
Ses derniers ouvrages sont La force de guérir (1999) et Le goût de vivre, (2005), Editions Odile Jacob.
Revue de psychologie de la Motivation. 1997 ¾ N° 24
TRANQUILLITÉ ET TRANQUILLISANTS
POUR UNE APPROCHE PERSONNELLE
ET SYSTÉMIQUE DE LA SANTÉ
" Mais j'ai cru trouver au moins bien des compagnons en l'étude de l'homme. J'ai été trompé : il y a encore moins qui l'étudient que la géométrie. Ce n'est que manque de savoir étudier cela qu'on cherche le reste "
Pascal
Armen TARPINIAN : Le mot « autrement » est à la mode. L'élection législative récente n'était-elle pas placée par les uns et les autres sous l'invocation du "gouverner autrement"? Le mot renvoie au sentiment que chacun éprouve plus ou moins clairement qu'il faut repenser, dans le fond et non seulement dans la forme, nos valeurs et nos modes de vie, si on ne veut pas aller, comme on dit, dans le mur. L'insécurité vient, paradoxalement, de ce que les progrès de tous ordres, tout en nous apportant du mieux-être, nous font craindre — et vivre — le pire... Les progrès de la technologie si prometteurs de "temps libéré" conduisent au chômage. Ceux de la médecine à des maladies nouvelles ou à des dérives. Votre dernier livre, Le Prix du bien-être, en traite un des aspects particulièrement important : l'usage abusif des médicaments psychotropes (tranquillisants, antidépresseurs, hypnotiques, neuroleptiques) auquel nous pousse un système très complexe de causes individuelles, collectives, idéologiques, commerciales. Votre livre, ou plus exactement le rapport officiel que vous aviez présenté et dont il est inspiré, a fait, comme on dit, du bruit dans Landernau, ou jeté un très gros pavé dans la mare…
Mais avant de nous raconter cet épisode, de nous dire comment en venir à des usages plus raisonnables de ces médicaments, et comment, surtout, sortir d’une approche trop réductionniste de la maladie et de la santé, pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel? Vous avez été, si je ne me trompe, un promoteur, sinon, le promoteur en France de la "psychiatrie biologique". Ne s'agissait-il pas d'une tendance à vouloir expliquer la maladie mentale par des causes essentiellement neuro-biologiques ? Comment en êtes-vous arrivé, comme le montrent vos derniers ouvrages, à la conception "systémique" de l'art médical?
Un parcours
Édouard ZARIFIAN : Je ne me suis pas dirigé vers la médecine par goût. Cela a été un concours de circonstances et, au fond, la manière de réaliser le désir de mes parents. Mes goûts étaient littéraires, j'étais passionné par l'espagnol. J'ai failli partir comme lecteur de français à l'université de Mexico, et c'est en raison de circonstances personnelles et familiales que je me suis inscrit au PCB à l'époque. C'est la mort dans l'âme que j'ai dû réduire mes lectures pour préparer les concours. Je rêvais aussi d'être journaliste. J'ai d'ailleurs tenu pendant cinq ans la rubrique médicale du Figaro, puis j'ai été rédacteur en chef du premier journal médical vidéo qui s'appelait Médiscope. Ma carrière médicale a donc été sinueuse et entrecoupée de périodes très différentes, sans que j'interrompe jamais ma pratique psychiatrique. J'ai eu une formation classique, j'ai été interne des hôpitaux de Paris, puis chef de clinique. Lorsque j'étais externe, j'ai eu pendant deux ans une formation analytique, bien que je ne pensais pas alors devenir psychiatre; mais je ne me suis pas engagé dans un cursus psychanalytique.
J'ai fait mon internat en neurologie et c'est là que j'ai découvert la neurobiologie. J'avais été très influencé par Jean Delay chez qui j'avais été externe et qui m'avait montré que la psychiatrie permettait d'être médecin sans abandonner pour autant le plaisir de la lecture et les recherches littéraires. Cela m’a déterminé à me diriger vers une médecine qui ne soit pas strictement somatique. J'ai en effet introduit en France, avant les années 1980 — cela était tout nouveau à l'époque — les techniques de psychiatre biologique que j'avais découvertes aux États-Unis. Ces techniques, que je ne peux détailler ici, concouraient à la recherche d'un index biologique authentifiant l'organicité d'un trouble psychique. J'ai créé en 1978 l'Association française de psychiatrie biologique dont j'ai été secrétaire général pendant sept ans et que j'ai quittée parce que j'étais en contradiction avec les dérives que je constatais. En effet, cet axe de recherche tendait à s’imposer comme la représentation unique du sujet souffrant et, dans ses conséquences pharmacologiques, la modalité unique de traitement. La psychanalyse ayant probablement déçu un certain nombre de gens parce qu'elle a connu ses excès également, la psychiatrie biologique ouvrait des perspectives à condition toutefois de lui poser les bonnes questions, ce qui n'était pas le cas. La question "délirante" était : trouvez moi le gène de la schizophrénie.
A.T. : Quelles sont les bonnes questions ?
E.Z. : Ce serait par exemple : montrez moi le déterminisme biologique favorisant la vulnérabilité de tel ou tel sujet à développer des symptômes en fonction des événements personnels ou sociaux qu'il est amené à vivre.
Voyant les excès auxquels cela conduisait, les dérives, la récupération immédiate et formidable par les industries du médicament, j'ai pris une distance très critique où je n'épargnais pas mes propres publications précédentes... Cela n'a pas été sans contrecoup. On m'a dit : "Tu craches dans la soupe". Les gens ne vous autorisent pas facilement à moduler votre pensée, à changer d'attitude, à être critique à l'égard de vous-même. Surtout quand ils vous ont suivi, ils ont le sentiment d'être trahis. En réalité, mon expérience pratique, indépendamment de mes lectures et de ma formation analytique, me convainquait que je ne pouvais soigner en ne m'occupant que des symptômes. J'étais soucieux de la psychologie singulière de chaque individu, et grâce à la découverte de l'approche systémique, c'est-à-dire de l'analyse des systèmes de communication entre les êtres, je me suis beaucoup intéressé à la dimension sociologique.
L'étape où je me trouve actuellement me conduit à accorder une place importante à la spiritualité : aux approches religieuses ou philosophiques de chacun. Ne faut-il pas défendre l'idée que l'homme est à la fois un corps biologique sur lequel on peut avoir une action matérielle et pharmacologique, un psychisme qui est unique (je dis à mes amis neurobiologistes "tous les cerveaux morts se ressemblent à peu près, aucun cerveau vivant n'est identique à un autre"), mais qu'il a aussi une troisième dimension que j'ai envie d'appeler l'âme, qui est ce besoin de spiritualité qui parait spécifique à l'homme et qu'on ne peut jamais complètement gommer quelles que soient les situations de crise, les dictatures, les génocides etc. Au fond il faut être fier de cela plutôt que d'avoir une attitude bêtement matérialiste en disant : "Vous refusez la modernité", comme je me l'entends dire par certains neurobiologistes. Je suis actuellement plongé dans ces questions. J'ai mesuré aussi mon inculture dans bien des domaines et j'essaie, à 55 ans, de rattraper le temps perdu. Je suis plongé dans l'histoire des religions et j'y découvre plein de clés pour comprendre le présent. Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël et dans les pays qui l'entourent, comment comprendre ce qui se passe à Jérusalem si l'on ne connaît pas l'histoire de Jérusalem? Et c'était des pans entiers d'information qui me manquaient complètement. Ainsi, grâce à votre revue, j'ai découvert Diel. Ce n'était qu'un nom pour moi. J'ai commencé à aborder son oeuvre. Sa vision de l'évolution et du symbolisme des mythes est tellement riche qu'il ne faut pas que je lise cela en diagonale... Ainsi, ses pages sur le mythe d’Asclépios m'apportent un réconfort extraordinaire et l'envie d'approfondir ma réflexion. Sa conception de l'interaction entre l’harmonisation intérieure et l'hormonisation éclaire vivement le lien entre la sagesse intuitive de la médecine antique et les recherches psychosomatiques d'aujourd'hui.
Les psychotropes
A.T. Nous pourrions en venir, si vous le voulez bien, à votre dernier livre, aux enjeux qu'il soulève, aux tabous qu'il ose attaquer, aux enseignements, et à la réflexion fondamentale où il conduit. Le thème de l'ensemble de ce numéro étant "le quotidien autrement", ce que nous voudrions pouvoir peut-être montrer avec vous, c'est ce que nous coûte individuellement, socialement, économiquement, notre incompréhension de ce que nous vivons réellement au niveau de notre santé physique et mentale.
E.Z. Pour répondre à votre question, je partirai du fait que la médecine aujourd'hui me semble fascinée par la science. Certes, elle doit emprunter à la science pour être plus performante dans son exercice quotidien, mais sa démarche est différente. La science a pour but d'expliquer, la médecine de soigner. Or on voit le rapport inter-humain s'effacer au bénéfice de la réparation d'organes. On en arrive à parler du clonage humain comme possibilité de constituer des banques d'organes.
Cette situation de la médecine me rappelle le livre de Jules Romains Hommes, médecins, machines où il se gaussait d'un test extraordinaire, le test de l'ongle, qui consistait à envoyer un certain rayon sur l'ongle du pouce; l'angle de réfraction permettait de déduire les maladies des patients, et très vite apparaissaient les spécialistes de l'ongle droit et les spécialistes de l'ongle gauche. J'ai vu aux États-Unis se mettre en place cette médecine; je pense à un haut lieu de la technologie médicale, la Mayo Clinic à Rochester dans le Minnesota: on entre dans un tunnel où de part et d'autre se trouvent des cabinets de médecins spécialisés; on vous demande de faire vos besoins dans un pot, vous passez cela par une petite lucarne, on vous met des tubes partout etc. Au bout du parcours, vous recevez le diagnostic sans avoir réellement « parlé » à un seul médecin.
C'est en réaction vitale à cette approche mécanique de l'être humain souffrant que j'ai écrit mes premiers livres pour le grand public. C'est sur la base du dernier d'entre eux, Des Paradis plein la tête, où je montrais le danger et la dérive de l'utilisation des médicaments psychotropes, que Simone Veil m'a demandé de faire une véritable enquête portant sur l'usage des psychotropes en France, en le comparant à l'usage qui en est fait dans les autres pays d'Europe et en essayant de comprendre le pourquoi des différences. Les pouvoirs publics ont souhaité que ce soit l'affaire d'un homme seul et pas d'un groupe de travail pour éviter le risque d'aboutir à un consensus mou. Je me suis entouré toutefois d'un comité de pilotage représentatif de toutes les instances; je n'ai voulu laisser de côté aucune source d'informations. La demande était : aller jusqu'au bout des choses, ne rien laisser dans l'ombre. Mais je ne me suis pas rendu compte que c'était à mes risques et périls. J'ai fait deux choses qui m'ont valu les réactions que je vais vous décrire. D'une part, j'ai décrit le système de santé ; or la description d'un système est insupportable pour le système. J'ai rapporté par exemple des comportements d'individus qui ne sont reconnaissables que par ceux qui sont concernés. Cela m'a valu et me vaut une hostilité incroyable. D'autre part, j'ai montré les risques de trafics d'influences sévissant à l'Agence du médicament ainsi que la confusion des genres : faire partie des commissions de recherche et d'expertise et, dans le même temps, émarger à des laboratoires pharmaceutiques dont on juge les produits...
J'ai donc à la fois décrit un système et j’ai contesté l'impartialité de certains experts. Je l'ai fait à un moment où d'autres affaires allaient mettre en cause cette impartialité : la vache folle ou l'affaire de l'amiante etc. J'ai montré aussi que le médecin français, sauf à acheter des journaux de langue anglaise, dispose de très peu d'informations indépendantes des annonceurs. Or, la manipulation de l'information concernant l'utilisation du médicament génère chez le médecin des représentations des pathologies telles qu'elles induisent une seule attitude : la prescription de médicaments. Qu'il s'agisse de suicide, de dépression, d'anxiété, de difficultés conjugales, scolaires etc.
Ce rapport était initialement un rapport confidentiel. Et puis, un jour, il y a eu une fuite et L'Express a fait sa couverture avec un grand titre "Le rapport qui accuse l'industrie pharmaceutique". Cela a soulevé des remous énormes; j'ai été attaqué par mes pairs et par l'industrie pharmaceutique, bien sûr. On a essayé différentes mesures de rétorsion.
A la suite de ce rapport, mon éditeur , Odile Jacob, m'a poussé à m'expliquer de façon à ce que le grand public puisse me juger en fonction de ce que j'ai réellement dit. C'est ce que j'ai fait avec Le Prix du bien-être : j’y livrai le constat qu'en France, on consomme deux à quatre fois plus de médicaments psychotropes que dans n'importe quel autre pays d'Europe. Les chiffres sont préoccupants : 12% de la population française consomme tous les jours au moins un psychotrope depuis plus d’un an. Les psychotropes les plus consommés sont les tranquillisants (7%), puis les hypnotiques (3%), les antidépresseurs (2%) et le marché des antidépresseurs augmente tous les ans de 6% depuis 6 ans.
A.T. J'ai été frappé par la différence énorme entre la consommation des psychotropes en Angleterre et leur consommation en France.
E.Z. Les différences ne concernent pas seulement les médicaments psychotropes. Nous consommons en France deux fois plus d'antibiotiques que dans n'importe quel pays d'Europe, nous consommons quinze fois plus d'anti-migraineux, quatre fois plus de vasodilatateurs. Que se passe-t-il dans ces autres pays où existent également la promotion et la publicité pour les médicaments? Dans le cas de l'Angleterre, les médecins appartiennent à un service public. Aussi, qu'ils prescrivent peu ou beaucoup, ils n'en tirent pas d'avantages personnels. De plus, il existe une formation et une information continues indépendantes de la promotion. Si vous lisez, par exemple, The Lancet, vous n'y verrez pas de publicité. En France, la revue Prescrire est la seule qui ne contienne pas de publicité pharmaceutique. Créée conjointement avec les pouvoirs publics qui l’ont, au départ, financièrement aidée, elle est maintenant indépendante. Elle est lue par de plus en plus de médecins généralistes.
Le grand enjeu de la médecine de demain, c'est d'avoir une formation médicale continue indépendante de toute pression. La formation médicale continue est légalement obligatoire en France depuis un an. Jusqu'à l'année dernière, un médecin qui sortait de la faculté de médecine pouvait ne plus ouvrir un livre jusqu'à sa retraite. Une loi a été votée au Parlement. Certaines manifestations ou certains outils de formation (livres, revues, etc.) se verront attribuer des points d'accréditation et le médecin, en fin d'année, devra justifier d'un nombre de points minimum. Un conseil national de la formation médicale continue édicte actuellement des critères qui doivent garantir l'indépendance du contenu de la formation. Si nous ne parvenons pas à garantir cette indépendance, nous aurons une médecine de plus en plus insatisfaisante. Les pouvoirs publics ont adopté jusqu'à présent une attitude attentiste et observent de voir ce que va faire la profession. Car, il ne faut pas oublier que la santé est un gigantesque marché économique...
Certes, on ne crée pas l'anxiété existentielle mais on crée une entité fictive qui est le concept d'anxiété pathologique-maladie; et en utilisant tous les vecteurs habituels, la presse grand public, la presse féminine etc., on fait en sorte qu'il y ait une demande exprimée par l'usager de la santé, qui est devenu un consommateur de remèdes... Il suffit de penser aux antidépresseurs qui défraient la chronique. Il ne faut pas cependant se focaliser sur le médicament. Le marché économique de la santé, c'est toutes les infrastructures de santé (cliniques, appareillages, kits d'analyse biologique etc.). Il y a là des abus dont on n'est guère informé, sinon par des entrefilets dans les journaux : c'est l'exemple de ces nombreux chirurgiens poursuivis par la justice parce qu'ils avaient mis des genoux artificiels à des gens qui n'en avaient pas tous nécessairement besoin...
Plusieurs de mes amis m'ont reproché de leur compliquer la tâche parce que mes livres incitent les malades à poser des questions aux psychiatres. L'un d'entre eux m'a dit après la parution de Paradis plein la tête : "Tu casses la baraque !". Il voulait dire par là que les psychiatres ne pourraient plus dire ce qu'ils veulent aux malades. Or, j'ai peur d'avoir à leur compliquer encore plus la tâche car je veux dans mon prochain livre inciter les malades à se prendre en charge, à devenir co-responsables de leur santé et à poser des questions. A ne pas être passifs mais actifs dans la prise en charge de leur santé.
Le malheureux et le malade
A.T. Cependant, on ne peut oublier qu'il n'y a pas de conditionnement sans conditionnabilité. Il y a au départ une demande qui est : « Comment puis-je être aidé à ne plus me sentir malheureux, à ne plus me sentir un malade ? »
E.Z. Vous avez prononcé le mot : malheureux. Mon livre s'intitule Le Prix du bien-être. Il y a un glissement, une dérive : le malheureux devient le malade. Pour un directeur de marketing, c'est une situation de rêve, à savoir, que l'on prend une caractéristique inhérente à la condition humaine et l'on en fait un marché.
A.T. On ne peut s'empêcher de penser, d'autant qu'il s'agit d'une question d'actualité, au coût supporté par la Sécurité sociale.
E.Z. Vous avez tout à fait raison. La différence avec d'autres exemples, c'est qu'ici, c'est la communauté qui paie.
A.T. Dans votre livre vous dites qu'en Belgique, les benzodiazépines ont cessé d'être remboursés mais qu'ils continuent d'être autant consommés qu'en France. Comment l'expliquez-vous?
E.Z. Parce qu'il s'agissait d'un produit entraînant une dépendance. Lorsque l'on augmente le prix du tabac, on ne réduit pas significativement le nombre de consommateurs puisque les gens sont déjà accrochés. Mais lorsque le remboursement des vitamines, produit plus neutre, a été supprimé, les gens ont nettement freiné leur consommation.
A.T. Je voudrais vous poser une question directe. Ce que vous dénoncez avec beaucoup d'objectivité ne peut-il pas produire, à côté des effets positifs d'interrogation des malades par rapport à l'usage qui est fait des psychotropes, des effets négatifs, une sorte de placebo nocif, un nocebo, face à un usage thérapeutiquement nécessaire?
E.Z. C'est là une véritable préoccupation. Le vrai risque de mes prises de position, c'est qu'elles jettent une défiance sur des médicaments que je juge indispensables pour certaines personnes. Mon combat concerne l'utilisation abusive de médicaments psychotropes par des personnes qui n'ont pas de troubles psychiques se situant dans le cadre de la pathologie. Cela complique presque inévitablement la tâche du médecin; mais ne doit-il pas en faire une occasion d'enrichir la relation, l'échange patient-médecin? Sans minimiser la difficulté, je suis convaincu que le silence sur l'usage abusif des psychotropes est infiniment plus maléfique.
Politique de la maladie et politique de la santé
A.T. J'aimerais maintenant que l'on dépasse l'aspect strictement économique. La médecine aurait tendance à nous considérer seulement comme organes, la spiritualité seulement comme âme, la société comme être social. Donc comment sortir de ces conceptions réductrices? Je rappellerai cette réflexion de Basarab Nicolescu dans le dernier numéro de notre revue : "La connaissance ou l'ignorance de ce que nous sommes, de notre être intérieur, a certainement des répercussions considérables sur la santé individuelle et sur les choix de nos politiques de santé. En fait, nous sommes plutôt prisonniers d'une politique de la maladie et des réponses surtout techniques que nous proposons, au lieu d'essayer de concevoir une véritable politique de la santé. Les patients sont traités en objets atteints de toutes sortes de handicaps organiques, de maladies, mais l'importance de la sécurité ou de l'insécurité intérieure est fort peu prise en compte. Nous avons même créé de nouveaux types de maladies, celles induites par les soins médicaux : les maladies iatrogènes (*) . Cette situation, coûteuse à tous points de vue, appelle de vrais changements de mentalité conduisant à réintégrer les dimensions de l'univers intérieur dans la discipline médicale."
Vous, Professeur Zarifian, votre réflexion, je suis sûr, vous a conduit dans cette direction. Comment aller d'une politique de la maladie à une politique de la santé?
E.Z. Vous savez, dans notre société en général et dans le domaine médical en particulier, nous allons complètement à rebours de ce que proposait Kant, à savoir que l'homme doit être une fin et non un moyen. Par ailleurs, l'hyper-prescription de psychotropes et de médicaments en général, exploite la croyance que tout ce qui peut nous être bénéfique doit venir de l'extérieur, plaçant ainsi les individus dans une situation de passivité-dépendance. Dire aux gens : "Il y a des ressources en vous" apparaît presque comme subversif.
Comment en sortir ou comment s'en sortir? Il faut faire référence nécessairement à l'individu et au groupe. La situation actuelle est alimentée essentiellement par les représentations sociales et par les représentations individuelles. Les représentations sociales sont très difficiles à modifier. Les représentations individuelles sont les seules que l'on puisse espérer modifier rapidement. Pour que les représentations sociales changent, il faut qu'une masse critique d'individus au sein du groupe ait modifié ses représentations individuelles. Les logiques économiques des industries touchant aux médicaments entrent aujourd'hui de manière aiguë en conflit avec l'éthique. L'éthique en santé publique, c'est de ne pas nuire. Prenons l'exemple des antibiotiques. On en consomme en France deux fois plus que dans n'importe quel pays d'Europe. Or, les antibiotiques utilisés par les médecins généralistes sont ceux de dernière génération. Ces antibiotiques, qui sont les plus puissants, vont très vite devenir inefficaces car l'on va fabriquer des germes résistants. Utilisés exclusivement, comme ils auraient dû l'être, dans les pathologies où elles s’imposent, ils n’auraient pu constituer un marché.
Pour revenir à votre question sur la santé, je voudrais faire une comparaison entre le français et l'anglais. En français, il n'y a qu'un seul mot pour désigner la maladie alors qu'il en existe trois en anglais : le mot disease signifie maladie en tant que savoir du médecin sur la maladie; le mot sickness représente le savoir du malade et ses représentations sur sa maladie; le mot illness désigne la représentation sociale de la maladie. Lorsque l'on prend en compte ces trois aspects, comme j'essaie de le faire dans ma pratique, le mot guérison devient un discours à trois voix qui doivent coïncider : vous êtes guéri; je me sens guéri; il est guéri.
A.T. Cette triple approche permet-elle de mieux diagnostiquer les causes de la maladie qui peuvent être biologiques ou/et psychiques?
E.Z. Disease, c'est le biologique, sickness, c'est le psychique et illness, c'est l'interaction entre le sujet et le milieu
A.T. A propos de cette interaction, vous rappelez dans votre livre que la médecine, ce n'est pas seulement administrer des médicaments. La médecine, c'est aussi la relation, le sujet qui consulte n'étant pas seulement un corps souffrant. On peut déplorer qu'une évidence aussi criante ne soit pas méthodiquement prise en compte.
E.Z. C'est la différence entre disease et sickness. C'est savoir aider celui qui souffre à discerner ce qui est une souffrance pathologique, nécessitant l'intervention du médecin, de la souffrance humaine naturelle qui ne requiert pas les mêmes réponses. Je prendrai un exemple. Une dépression vraie est une souffrance psychique qui nécessite un traitement médicamenteux et psychologique; par contre, un deuil est une souffrance considérable que je peux être amené à aider mais pas de la même manière et pas en tenant le même discours.
Tranquillité et tranquillisants
Ce que je ne veux pas, c'est qu'à partir des symptômes qui caractérisent la dépression et dont certains caractérisent aussi la tristesse, on baptise dépressifs des gens tristes.
Certains me disent "Tu laisses souffrir les gens". Non, refuser de donner un tranquillisant, cela veut dire donner beaucoup de temps, on est alors efficace sans être nocif.
A.T. Oui, il doit y avoir d'autres voies pour retrouver la tranquillité que les tranquillisants. Votre remède, c'est le temps qui permet la relation. Il s'agit d'une donnée qui n'est pas prise en compte par la Sécurité sociale, alors qu'à y réfléchir de près, ce serait une bonne voie pour assainir ses comptes...
E.Z. De plus, utilisés à bon escient, les tranquillisants peuvent procurer un certain bienfait, mais utilisés par des gens qui ne souffrent pas d'une anxiété pathologique, inhibante, ils présentent beaucoup d'inconvénients. Et lorsqu'on en consomme depuis des années, comme c'est le cas de beaucoup de Français, cela entraîne une indifférence affective dont personne n'a mesuré les conséquences sur la vie conjugale, sociale, professionnelle, ni sur les accidents du travail et de la route... J'ai parlé à cet égard de génocide de l'esprit.
Autre aspect des choses. Aujourd'hui, on ne meurt plus de méningite tuberculeuse. Les performances de la médecine sont tellement extraordinaires qu'on en attend plus que de raison. La médecine est devenue le foyer de projections magiques intenses. Mais rapporté à la réalité des faits, il faut s'interroger sur ce qui revient à l'impact des médicaments dans les progrès de la santé publique. On sait que les progrès de la médecine n'interviennent que pour 10% environ dans l'amélioration de la santé. D'où vient le reste? Cela vient d'abord de la nutrition. Ensuite de l'hygiène. On ne peut cependant voir les choses par le petit bout de la lorgnette en appuyant nos réflexions uniquement sur la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce que la santé en Afrique Noire, où la méningite cérébro-spinale sévit de manière endémique et où on ne donne jamais, faute d'argent, de médicaments ? La tuberculose est endémique dans les favellas du Brésil. Pourquoi? Il y a bien des remèdes antituberculeux mais il n'y a aucune hygiène et pas de nutrition. La tuberculose resurgit en France parce que l'on connaît un sous-prolétariat. Donc, on ne peut penser antibiotiques sans penser aussi hygiène et nutrition. Cela ne peut en rien diminuer l'intérêt majeur du médicament, mais il ne faut pas dire, pour des raisons économiques, où le profit prévaut sur toute autre valeur : « Il ne leur manque que le médicament qui sauve. » (*)
La formation
A.T. On a, à l'inverse, dans les sociétés très développées, des maladies dues non pas à la sous-nutrition mais à la surnutrition...
Pour en venir au problème central de la formation, vous insistez sur le manque d'informations des médecins — et du public — sur les effets pervers de l'usage abusif des psychotropes et autres médicaments. Vous venez de rappeler que les médecins sont préparés à soigner des organes plus que des personnes. Mais n'y a-t-il pas des percées, des évolutions positives qui s'observent ici ou là? La psychanalyse, la recherche psychothérapique et psychosomatique, ne font-elles pas tomber les préjugés?
E.Z. On a pris en partie conscience de ce problème lorsque justement on a voulu introduire les sciences humaines en début d'études de médecine. Mais cela a été fait de manière précipitée et n'a pas porté ses fruits.
Je dois vous dire que je me suis élevé contre le fait qu'il n'y a que trente heures d'enseignement théorique en psychologie médicale pendant les huit ans de médecine. Et l’on peut déplorer que pendant les quatre ans de formation des futurs psychiatres, il n'y ait, au niveau national, aucun enseignement systématiquement organisé qui initie à la relation médecin-malade et à la prise en charge psychothérapique. En Allemagne, un infirmier psychiatrique doit, lors de son cursus, avoir des entretiens pendant un an avec au moins un patient sous la supervision d’un psychothérapeute-formateur.
La négligence du fait psychique est quand même le résultat de la glorification de la science toute puissante. Ce que la science, ou plutôt l'idéologie scientiste, n'explique pas ou ne peut pas appréhender, elle le nie ou bien le minimise. Certaines cultures prennent en compte des aspects de l'homme négligés chez nous et peuvent même aboutir à des faits absolument indéniables, non expliqués par la science officielle. Le scientisme nie ces faits, comme par exemple l'influence de la volonté sur la fréquence cardiaque.
Je pense cependant que les généralistes sont plus proches d'une conception disons personnaliste de leur métier. Pour ma part, le combat que je mène est aussi pour eux. J'ai vu des médecins généralistes tout à fait remarquables, connaissant les familles, comprenant les choses, intervenant comme il faut.
A.T. Peut-on donner une définition de ce que peut être une véritable activité médicale, proposer une sorte de modèle idéal et voir comment il peut être appliqué, en tenant compte des contraintes inévitables? De même qu'il nous faut redéfinir l'acte pédagogique, il me semble qu'il nous manque une vraie conception de l’acte médical. Comment la définiriez-vous ?
E.Z. Je reprendrai les trois aspects que j'ai évoqués avec les trois mots anglais qui désignent la maladie : disease, sickness, illness. Le premier aspect est la prise en compte du savoir médical et scientifique. Le deuxième aspect concerne la capacité à écouter l'autre en tant que sujet unique. Un de mes professeurs disait : « C'est le malade qui doit vous apporter le diagnostic. » Il faut écouter avant d'examiner. Or, aujourd'hui, on n'écoute guère, on se précipite plutôt sur les examens complémentaires. Le troisième aspect contribue à situer le sujet souffrant dans son environnement relationnel et à identifier les représentations qu’il en a.
La psychologie médicale
A.T. Pourriez-vous préciser la différence entre psychologie médicale et psychologie curative ? Être plus au fait de la psychologie médicale ne veut pas dire forcément que l'on est psychothérapeute ?
E.Z. Pas du tout. Être psychothérapeute nécessite une formation spécifique. En revanche, la psychologie médicale que j'enseigne concerne la vérité à dire ou à ne pas dire aux malades, le secret professionnel, la réflexion sur le normal et le pathologique, le sens des mots soigner, guérir, les représentations individuelles et sociales de la santé et de la maladie, et bien sûr ce qui concerne la relation patient-soignant. Une initiation à la psychothérapie — vous diriez peut-être à la relation d’aide — est une chose, être psychothérapeute en est une autre. En revanche, ce qu'on peut apprendre aux médecins en général et a fortiori aux psychiatres, c'est à comprendre mieux ce qui se passe ici et maintenant, dans le registre du récit de ce que vivent les gens et de ce qui se passe dans la relation thérapeutique. (Il existe, comme on sait, les groupes Balint, mais ils sont malheureusement trop peu développés). La psychothérapie des profondeurs qui met en jeu le rêve, l'inconscient, c'est autre chose.
Le normal et le pathologique
E.Z. Dans le domaine de la souffrance psychique, le curseur peut être déplacé comme on veut, et ce qui m'inquiète, c'est qu'on le fait bouger d'une manière illégitime. Comme je l'ai dit, on transforme les malheureux en malades. Car la différence en matière de souffrance psychique entre le normal et le pathologique est uniquement une convention, un consensus liés à la culture, au lieu et au moment. Ne soyons pas dupes de cela.
En ce qui concerne par exemple le délire, on peut dire que le délire de chacun a un sens. Lorsque dans ma pratique, je vois pour la première fois un malade délirant, je ne me précipite pas sur les neuroleptiques, j'écoute d'abord ce qu'il a à dire. Ce serait sinon le réduire à son symptôme.
A.T. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par sens du délire?
E.Z. Le sens du délire concerne d'une part l'histoire du sujet. Les thèmes du délire diffèrent en fonction de cette histoire (thèmes de grandeur, de salut, de persécution etc.). Pour aider le sujet, il faut avoir entendu ces thèmes afin d'en parler avec lui une fois que le dialogue est à nouveau possible. Ne pas en parler, mépriser le délire, c'est laisser l'individu avec une cicatrice indélébile et une culpabilité considérable.
D'autre part, le délire a un sens qui concerne l'économie adaptative du sujet. C'est la tentative ultime, désespérée et infructueuse d'être soi-même face à des contradictions, à des coercitions, à des contraintes, à des conditionnements. Cela ne veut pas dire que je laisse le malade délirer, que je n'utilise pas de neuroleptiques, mais je les utilise sur des périodes beaucoup plus courtes que ce qui se prescrit généralement.
Santé et auto-responsabilité
J’ai dit que les gens doivent apprendre à devenir responsables de leur santé. Cela signifie qu'il faut les informer : chaque citoyen devenu malade a le droit à une information. Je ne dis pas ici qu'il faut forcément dire la vérité au malade. Le médecin doit discerner ce que le patient souhaite entendre. Mais il faut que les gens établissent un partenariat avec le médecin. La question est : "Qu'est-ce qu'on fait ensemble?" A cet égard, le cas du sida constitue un événement majeur dans l'histoire de la médecine. Les sidéens sont devenus détenteurs de l'information au même niveau que le corps médical; ils vont dans les congrès internationaux et sont devenus des partenaires de discussion avec les pouvoirs publics, le corps médical et l'industrie pharmaceutique (ils font baisser les prix de la trithérapie).
C'est bien sûr un cas particulier mais je souhaiterais que les gens participent activement à leurs soins. Un ami me disait " Tu parles en terme de pouvoir médical; quand je vais chez mon garagiste, je ne discute pas". Je lui ai répondu que, justement, il avait tort.
A.T. Les automobilistes ne seraient pas perdants à connaître un peu plus la mécanique... Il faudrait évidemment que les médecins eux-mêmes soient un peu plus au fait de leur propre fonctionnement psychique, de leurs désirs, intentions, motivations.
E.Z. Il est très intéressant d'interroger les médecins qui ont été malades. Certains médecins ont "redécouvert" la médecine après avoir traversé eux-mêmes une grave maladie. Mon maître, Jean Delay, membre de l'Académie française et de l'Académie de médecine, qui avait été hospitalisé à l'hôpital Broussais pour un infarctus du myocarde, me racontait qu'il s'était senti infantilisé par la manière dont il était traité.
A.T. Vous disiez que 90% des progrès de la santé tenaient à des modifications des modes de vie (nutrition, hygiène etc.). Quelle part faites-vous aux autres aspects, culturels, affectifs, psychologiques?
E.Z. J'ai lu chez Diel des choses auxquelles je ne peux que souscrire. Il fait remarquer que même dans le cadre d'infections à germes figurés, tout le monde ne contracte pas cette infection. L'état psychique influe sur l'hormonisation (*).
J'ai personnellement un modèle qui guide ma réflexion : le modèle du "seuil". Je pars d'une idée très simple. Notre cerveau peut, dans des circonstances extraordinaires, connaître n'importe quel trouble psychique. Nous arrivons au monde avec un déterminisme génétique et biochimique qui nous donne un seuil d'apparition des symptômes en fonction de l'interaction que nous avons avec notre milieu et de ce que nous rencontrons dans notre existence. Certains ont un seuil normal; face à des événements "normaux", ils ne présenteront jamais de troubles. D'autres ont un seuil bas (c'est le domaine de la psychiatrie biologique de déterminer ce qui caractérise ce seuil); face à des événements "normaux", ils présenteront quand même des symptômes. Mais ceux qui ont un seuil dit normal présenteront des symptômes s'ils sont confrontés à des événements particuliers : dans des circonstances extraordinaires, tout le monde est sujet à des troubles psychiques.
Cette notion de seuil permet de montrer qu'il n'y a pas de gens normaux ou anormaux mais qu'un ensemble de circonstances peut favoriser l'apparition de troubles. En réponse, on voit toutes les thérapies qui sont possibles : la thérapie biologique qui agit sur le seuil, les thérapies psychologiques qui agissent sur les représentations mentales et sociales, les thérapies comportementales qui nous permettent de modifier notre relation à l'environnement. Aujourd'hui, on est dans le mythe de la biologie moléculaire toute puissante qui ferait dépendre d'une pilule l'évolution complexe et fragile d'une vie.
Il y a cependant une demande des patients qui de plus en plus essaient de trouver des gens capables de les écouter, de les entendre, de les comprendre. J’en ai un vif écho dans les auditoires très hétérogènes auxquels j’ai été confronté (13 villes pour mon dernier livre). Il y a là une majorité silencieuse qu’il faut aider à se faire entendre. L’espoir est plutôt là...
Le rappel du refoulé : l'effet placebo
A.T. Je souhaiterais pour finir vous interroger sur un problème que vous connaissez bien — l'effet placebo — que vous continuez d'étudier, je crois, sous son aspect biologique. Cela est évidemment très important. Pour nous, du point de vue du fonctionnement psychique, cela nous parait être un phénomène central.
On peut s'étonner que l'évidence de l'effet placebo ne contribue pas à mieux ébranler les certitudes organicistes et mécanistes qui constituent le fond de la formation médicale, pas plus d’ailleurs que l’effet-Pygmalion n’ébranle les certitudes des enseignants [1].
Il ne s'agit pas bien sûr de sous-estimer les progrès immenses de la médecine. Mais ses succès laissent dans l'ombre ou font considérer comme très secondaires les déterminations inconscientes qui contribuent à la santé ou la compromettent. Cela est d'autant plus paradoxal que ce phénomène d'ordre psycho-biologique est pris en compte méthodiquement dans la recherche de validation des médicaments. Peut-être consacrerons-nous un numéro de la revue à l'effet placebo tant le phénomène nous apparaît riche de sens comme d'implications pratiques [2] .
E.Z. L'effet placebo est un phénomène relationnel mais qui comporte un substrat biologique. Il est vrai que cela me passionne et continue de faire l'objet de mes recherches. Je peux vous citer l'exemple très parlant d'une expérience faite avec des personnes souffrant de douleurs bucco-dentaires. Il faut se rappeler que n'importe quelle prescription contenant un pseudo-médicament — le placebo — provoque, en moyenne, 30% d'amélioration constatable, par le double mécanisme de suggestion mentale et de sécrétions d'endorphines naturelles qui l'accompagnent.
On a donc administré à un premier groupe deux gélules, l'une pur placebo, l’autre contenant de la naloxone. La naloxone est le bloqueur de l'effet de notre morphine naturelle (qu'on appelle les endorphines). A un deuxième groupe, on a administré deux gélules qui étaient toutes deux du placebo. Dans ce deuxième cas — placebo plus placebo —, il y a eu 30% d'effet positif. 30% des gens ne ressentaient plus de douleurs. Dans le cas placebo plus naloxone, seuls 5% des gens, et cela est hautement significatif, ont reconnu ne plus souffrir. Cela a permis de démontrer que dans une relation médicale, où, pour reprendre le mot de Lacan, un "sujet supposé savoir" et supposé soigner s'adresse à un sujet qui est demandeur, on induit par cette "alchimie" psychologique un effet biologique, la sécrétion d'endorphines. La sécrétion d'endorphines ainsi produite va dans le sens d'une atténuation de la douleur, même si à l’expérience elle a une efficience moins puissante qu'un médicament antalgique.
A.T. Médicament qui bénéficie de toute façon de l'effet placebo.
E.Z. Bien sûr. Il faut toujours soustraire de l'effet pharmacologique l'effet placebo qui est, comme je l'ai dit, de l'ordre de 30% quelles que soient les pathologies, et quelquefois beaucoup plus. Dans l'anxiété, par exemple, cela atteint 60%. Auquel cas, on peut s'interroger sur l'opportunité d'utiliser un produit plus ou moins nocif. En administrant la naloxone, on a bloqué la sécrétion d'endorphines. Le substrat biologique de l'effet placebo a donc été contrecarré, ce qui explique qu'il n'y a eu que 5% d'effet positif. On a donc ainsi démontré que l'effet placebo dans la douleur était dû à l'induction par la relation de la sécrétion d'endorphines naturelles. L'effet placebo dans l'ulcère de l'estomac, c'est 30%. Si la biologie s'intéressait aux mécanismes biologiques mis en œuvre par l'effet placebo dans l'ulcère de l'estomac, on se trouverait au plus près de la co-pathogénie physiologique de l'ulcère gastrique. On découvrirait la substance qui provoque l'ulcère gastrique. C'est un champ de recherche extraordinaire ; il est donc fort attristant que la médecine tire si peu de leçon de l'effet placebo, tout en le reconnaissant puisqu'il ne se fait plus d'essais thérapeutiques sans un groupe contrôlé sous placebo.
A.T. La richesse d’enseignement de l'effet placebo n’appellerait-elle pas une approche inter et trans-disciplinaire de la santé et de la maladie prenant en compte, comme vous le disiez, le corps, l'âme et l'esprit, le biologique et le social, le mental et le culturel ? Mais aussi, la solution de la crise sociale générée par les fameux déficits de la Sécurité sociale, ne dépendrait-elle pas, pour une large part, d’une formation repensée des études médicales incluant ces dimensions, ainsi que d’une éducation à la santé assurée dès l’école primaire ?
E.Z. Vous parlez d’or, dans tous les sens du terme...
Il nous faudrait d’urgence, en effet, à l’école et à la faculté, apprendre à sortir de nos tendances réductionnistes, à redécouvrir la complexité du vivant, à nous placer dans une perspective à la fois personnelle et systémique de la santé et de la maladie, afin de mieux comprendre pour mieux agir non seulement curativement mais tout autant et avant tout préventivement.
Citations : Paul Diel, Mythe d’Asclépios, Extraits (1954) (*)
« Même la cause, peut-être la plus importante des maladies organiques, l’infection, n’est pas due nécessairement et exclusivement à la contamination accidentelle. L’organisme est porteur de germes, et l’affaiblissement de la résistance dû au désordre psychique sera souvent une cause suffisante d’envahissement ».
« La santé du corps dépend de l’harmonie de l’hormonisation. Cette affirmation, commune à Hippocrate et à la médecine moderne, n’est en somme qu’une inversion de la sagesse mythique, qui, exprimée en termes non symboliques, peut se formuler ainsi : l’harmonie des corelations neuro-hormonales dépend de la vie psychique et de son harmonie, donc de la force de spiritualisation-sublimation (dont le symbole est Apollon). »
« L’idéal serait de connaître aussi bien l’enchaînement des causes physiologiques que celui des motifs psychiques. Le désarroi de la psychiatrie moderne pourrait bien venir de l’incapacité où elle est d’établir le parallélisme de ces deux voies explicatives, ainsi que de la tendance à remplir les lacunes de l’explication physiologique par des explications psychiques, et les lacunes de l’explication psychique par des explications d’ordre physiologique. »
« Jusqu’à nos jours, l’esprit qui anime la science psychiatrique se montre plus restrictif que ne l’était la sagesse mythique. Non pas que la psychiatrie nie l’unité « corps-psyché » ; elle la souligne au contraire autant que faire se peut, mais uniquement dans l’espoir de comprendre les troubles de l’âme par l’étude exclusive du dérèglement somatique. La psychanalyse moderne, ouvrant la voie qui mène vers la compréhension du symbolisme mythique, peut être considérée comme une réaction contre cette limitation excessive du problème psychopathologique.
(*) Professeur de psychiatrie et de psychologie médicale, Université de Caen. Auteur de : Les Jardiniers de la Folie (1988), Des paradis plein la tête (1994), Le Prix du bien-être, (Psychotropes et société), Editions Odile Jacob.
(*) Dix pour cent des hospitalisations en France sont dues à des accidents thérapeutiques. Douze mille personnes par an meurent d’infections nosocomiales, c’est-à-dire dues à des germes contractés en milieu hospitalier.
(*) Lu, après cet entretien, dans Le Monde du 12 juin 1997 :
« L’émiettement social et culturel peut-il engendrer des hommes bien portants ? La réponse s’inscrit de plus en plus souvent dans un registre d’exigence ambiante de rentabilité. Les pressions économiques s’exercent à l’encontre du médecin et de son patient. Le premier écoute le second parler de sa santé, mais le manque de temps gêne l’écoute, et la réponse reste trop souvent confiée à un excès de médicaments, après trop de détours vers des examens complémentaires parfois complexes, coûteux et inutiles ». Dr. Gérard Azoulay, pédiatre.
Citons encore, dans le même numéro du Monde, le début du commentaire de J.Y. Nau, d’un article du journal The Lancet critiquant la mise sur le marché du Taxol (médicament contre le cancer des ovaires) : « L’usage plus que l’éthique, veut que les revues médicales ne soient jamais très critiques vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique en raison d’objectifs a priori associés au fait que ces revues trouvent généralement dans cette industrie la quasi-totalité de leurs indispensables ressources publicitaires... ». [NDLR].
(*) Voir extraits de Diel en fin d’article.
[1] L’effet-Pygmalion et l’effet-Persée. Revue N° 18, 1994.
[2] Voir le livre de Patrick Lemoine, Le mystère du placebo, Odile Jacob, 1996.
(*) Le symbolisme dans la mythologie grecque, P.B. Payot, 1995.